Retour sur un personnage central, mais peu connu, qui fut au cœur des négociations ayant conduit à la libération du diplomate britannique, détenu par le FLQ.
On sait que la Crise d’Octobre 1970 éclate le 5 octobre 1970 avec l'enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross par des membres du Front de libération du Québec (FLQ) qui exigent, en échange de sa libération, que plusieurs de leurs demandes soient satisfaites. On sait aussi que ces discussions permettront aux Felquistes d’obtenir un sauf-conduit pour Cuba, le 3 décembre 1970. Ce que l’on sait moins toutefois sur cette affaire, c’est que les négociations, qui permettront la libération de l’otage et le départ des Felquistes pour Cuba, sont conduites par Me Bernard Mergler, un avocat anglophone montréalais d’origine juive.
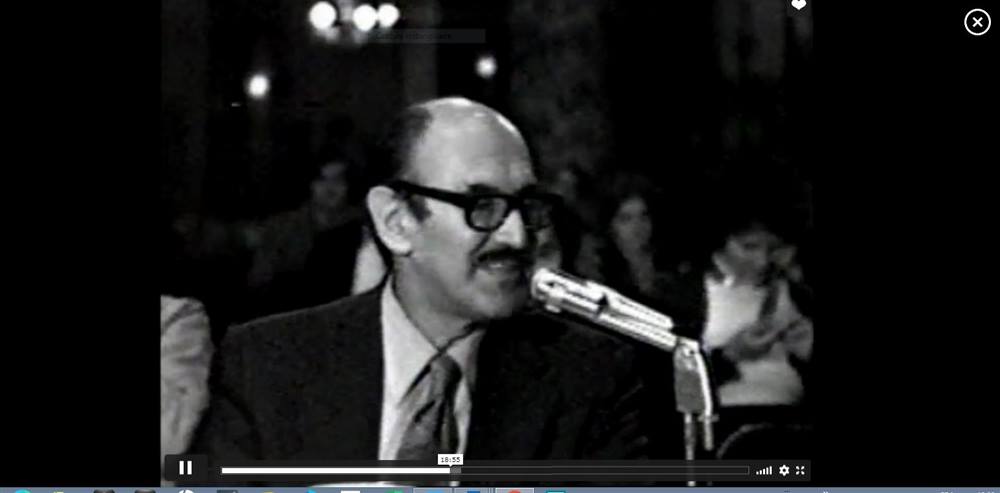
Me Mergler participant à une assemblée populaire sur les arrestations de la crise d'Octobre en 1971.
**
Ce qui est encore plus étonnant, c’est que dans leur dernier communiqué, les membres du FLQ, qui détenaient Cross depuis deux mois, avaient explicitement demandé que Me Mergler les représente dans leurs négociations avec les autorités québécoises et canadiennes.
Insuffisamment mis en évidence dans les nombreux récits portant sur la crise d’Octobre 1970, le rôle de Mergler est pourtant déterminant dans la libération de James Richard Cross. Ce qui est également assez intéressant de souligner, c’est que la plupart des récits de cet épisode tragique de l’histoire du Québec sont écrits le plus souvent par des auteurs qui adoptent un biais sympathique envers le FLQ.
Si l’on se doit de dénoncer les actions violentes du mouvement felquiste, cela n’excuse nullement les mesures excessives et opportunistes de Pierre Trudeau et des autorités provinciales et municipales qui profitaient des événements pour discréditer le mouvement indépendantiste. On sait que le gouvernement de Pierre Trudeau appliquera la Loi des mesures de guerre qui suspendra les libertés civiles et que la Sureté du Québec et la police de Montréal procéderont à plusieurs centaines d’arrestations de manière arbitraire. Rappelons toutefois que cette loi sera dénoncée par T.C. Douglas, le chef du Nouveau Parti démocratique, formation qui siégeait au Parlement fédéral.

Quant à Bernard Mergler, pourquoi en effet un avocat juif et anglophone aurait-il été mêlé dans les négociations visant à libérer le diplomate britannique ? Qui était-il ? Pourquoi les membres du FLQ ont-ils exigé qu’il les représente ? Quels rapports entretenait-il avec le Front de libération du Québec qui prônait la lutte armée ?
Jeune pigiste pour la revue québécoise Perspectives, j’avais consacré un reportage, à la fin des années 1960, aux déserteurs de l’armée américaine qui fuyaient la guerre au Vietnam et qui s’étaient réfugiés à Montréal. Contrairement aux « draft dodgers», les déserteurs étaient issus des classes les plus modestes de la société américaine, et ils risquaient la cour martiale aux États-Unis. J’apprenais en discutant avec eux qu’un avocat du nom de Bernard Mergler tentait de leur obtenir l’asile au Canada[1]. Il avait la réputation de défendre les droits des plus défavorisés de la société, souvent sans recevoir d’honoraires.
Héritier de la riche tradition juive de gauche, peu connue au Québec, Mergler se rattache aux progressistes juifs, tels que Léah Roback et son frère Léo. D’ailleurs Fred Rose, le seul député communiste à avoir été élu au Parlement fédéral, et ce à deux reprises en 1943 et en 1945, était d’origine juive. Il représentait la circonscription montréalaise de Cartier.
Je rappelle que j'ai consacré deux émissions de deux heures aux socialistes juifs du Québec dans le cadre de ma série de 14 émissions sur la communauté juive du Québec diffusées en 1982, à la radio de Radio-Canada. J’y avais interviewé longuement Léah Roback, militante de gauche et amie (ou amante ?) de Fred Rose, de même que le frère de Léah, Léo Roback. Moins connu que sa sœur, ce dernier était professeur à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal entre 1968 et 1982, et il était autant sinon plus que Léah activement impliqué dans les milieux ouvriers québécois. Il avait d’ailleurs commencé la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ ), quelques mois avant son décès, ouvrage qu'Émile Boudreau, son ami et compagnon d'armes, qui fut actif au sein de FTQ, a complété en 2002[2].
J'ai fait don des cassettes audio et des transcriptions de ces émissions au Service des archives de l’Université Concordia, qui détient le fonds de mes archives. (Les enregistrements de mes autres séries d'émissions, également diffusées à Radio-Canada, y sont aussi disponibles pour consultation sur rendez-vous avec les responsables.)
Pour revenir à Bernard Mergler
Plusieurs avocats, qui l’ont bien connu, alors qu'ils étaient en début de carrère, gardent un excellent souvenir de Me Bernard Mergler. Partisan convaincu d'un Québec souverain et socialiste, cela n’étonne guère que des membres du F.L.Q. demandent qu’il les représente ou qu’il soit leur conseiller dans les nombreux procès qu’ils subissaient. Juif, mais non pratiquant, il était respectueux de toutes les religions, selon les militants indépendantistes qui l’ont connu.
Fervent défenseur des droits de la personne, Mergler s’était battu contre le régime de Duplessis et la loi du Cadenas. Membre du Parti communiste canadien, il était critique de l’Union soviétique et du Stalinisme, mais il aurait fortement appuyé Fidel Castro et la révolution cubaine. Ces sympathies pour la révolution cubaine expliqueraient qu’il ait été le conseiller juridique et le représentant du gouvernement cubain à Montréal.
Les autorités cubaines, on le sait, avaient accepté d’agir en tant qu’intermédiaires entre les ravisseurs de Cross et les autorités québécoises et canadiennes.
C’est donc cet esprit d’engagement pour les peuples opprimés qui rapproche Mergler des Felquistes. Il sympathisait avec la cause des membres du FLQ, sans toutefois appuyer les moyens violents qu’ils avaient choisis.
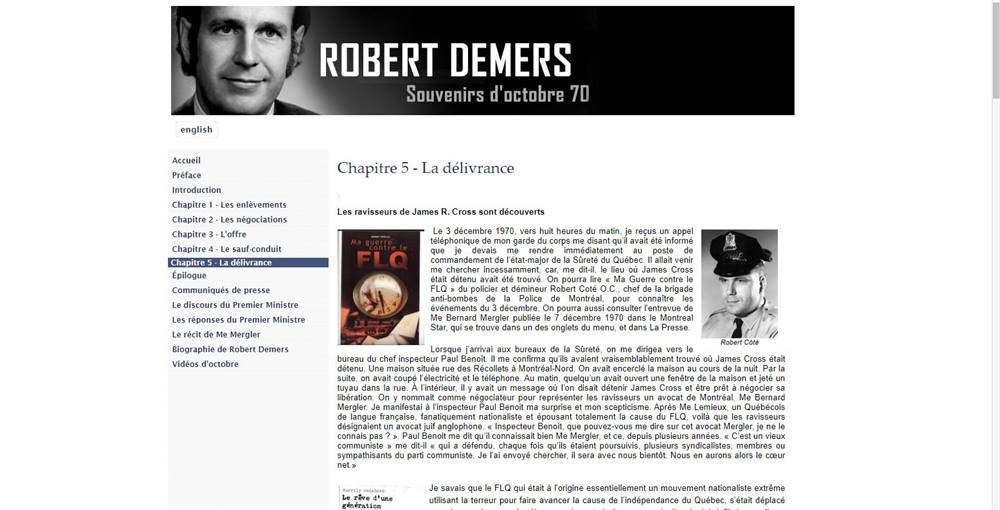
Un récit qui met en évidence le rôle de Bernard Mergler est celui de Me Robert Demers. On sait qu’en octobre 1970, le gouvernement du Québec désigne ce dernier pour négocier la libération des deux otages détenus par le Front de libération du Québec. Assez étrangement, c’est uniquement sur Internet que le négociateur du gouvernement québécois avait confié le récit détaillé du déroulement de ces négociations. Ce récit n'est plus disponible sur le WEB. Me Demers étant décédé en 2023, les « Souvenirs de maître Robert Demers sur la crise d'octobre 1970» semblent avoir été acquis depuis par le Musée canadien de l’histoire. Je reproduisais des extraits de ses souvenirs alors qu’ils étaient disponibles en accès libre sur Internet dans mon article sur le même sujet paru ici même en 2020.
J'ose espérer qu'un éditeur québécois publiera le récit intégral de Me Demers, car curieusement aucun ouvrage, accessible aux chercheur.es et au grand public, ne semble exister dans les bibliothèques du Québec. Cela représente un récit fondamental de notre histoire. Un tel ouvrage pourrait s'attacher aussi à faire connaître le rôle important de Me Bernard Mergler dans le mouvement progressiste québécois et sa place dans notre patrimoine.
Que dit donc ce récit du rôle de Mergler ?
Voici un large extrait du récit que fait Me Demers de la négociation qui fut entreprise pour la libération de Cross, dont j'avais indiquer en 2020 l'hyperlien pointant sur la page disparue depuis de Google dans laquelle il avait été publié.
« J’ai rencontré Me Mergler dans un bureau mis à notre disposition par la Sûreté. C’était un homme d’un certain âge, près de la soixantaine. La conversation s’est déroulée en partie en anglais, en partie en français. J’ai choisi de la rapporter dans ce document en français seulement. En me voyant, il m’a tout de suite dit : « Vous êtes l’avocat nommé par le gouvernement pour négocier avec le FLQ ? » J’ai acquiescé et je lui ai dit que la police avait trouvé l’endroit où les ravisseurs de James Cross se cachaient, une maison dans le nord de la ville. Je lui ai annoncé qu’un communiqué du FLQ le désignait comme leur négociateur. Je lui ai remis copie de mon dernier communiqué offrant aux ravisseurs de James Cross un sauf-conduit pour Cuba en échange de la remise de celui-ci sain et sauf.
« C’est ce que nous sommes prêts à faire, mais nous ne sommes plus prêts à négocier l’une ou l’autre des demandes initiales du FLQ », lui dis-je. « Ce que je veux de vous, c’est en premier lieu de confirmer l’identité de James Cross. Nous avons une question à lui poser qui permettra de l’identifier avec certitude. Ensuite, vous leur remettrez copie de mon communiqué et leur demanderez s’ils sont prêts à l’accepter.
La réponse de Me Mergler ne s’est pas fait attendre. « Je considère », me dit-il, « que je ne peux m’associer à une activité criminelle. C’est ce que je ferais si j’acceptais ce mandat. » Je fus un peu pris au dépourvu par sa réponse. Après Me Lemieux, qui était un inconditionnel du FLQ, je me trouvais en face d’un avocat qui refusait net d’agir. Mais je comprenais bien son point de vue, j’avais affaire à un avocat qui savait faire la différence entre représenter un justiciable devant la loi et prêter son concours à une organisation criminelle. Je m’efforçai donc de le convaincre d’accepter d’agir à la demande des gouvernements concernés et non du FLQ. Je lui ai offert de téléphoner immédiatement au ministre de la Justice du Québec, Me Jérôme Choquette, et au ministre de la Justice du Canada, Me John Turner, pour confirmer leur accord à ma proposition. Il est demeuré inflexible. « Je n’éprouve aucune sympathie pour le FLQ et ses objectifs », m’a-t-il dit « et je ne veux en aucun cas être assimilé à ce groupe. De plus, je suis âgé et mon état de santé laisse à désirer. Je vous demande de ne pas rendre public le communiqué du FLQ me désignant. » J’ai aussitôt pris le téléphone et j’ai demandé de retenir toutes informations concernant Me Mergler. Il me demanda aussi de ne faire aucune déclaration le concernant, ce à quoi j’ai convenu.
(…)
Je répondis alors à Me Mergler qu’il me mettait dans une situation bien difficile : « Je ne peux aller discuter avec les ravisseurs directement. Je prendrais alors le risque de devenir un prisonnier additionnel, peut-être même une autre victime. »
(…)
« Vous êtes la seule personne qui peut aller trouver ces felquistes sans risque puisqu’ils vous ont nommé. Les alternatives sont peu réjouissantes, si l’armée ou la police pénètre de force dans la maison, nous prendrions le risque de nous retrouver avec des morts et des blessés. J’ai le mandat du premier ministre Robert Bourassa de prendre des moyens qui assureront que James Cross aura la vie sauve. Le gouvernement de Cuba a accepté d’agir comme intermédiaire pour des raisons humanitaires, je vous demande de changer d’avis et d’accepter ce que je vous propose. Nous avons déjà Pierre Laporte qui est décédé, sauvons au moins James Cross. »
Cette discussion a sûrement duré plus d’une heure. Me Mergler semblait bien décidé à ne pas changer d’idée, mais à la mention du rôle de Cuba il m’a dit : « Écoutez, je vais aller voir le consul de Cuba. Je vais leur offrir d’agir pour eux et de les représenter dans cette négociation. S’ils acceptent, alors je ferai ce que vous me demandez. »
Le consulat de Cuba
Et nous voilà dans l’auto de mon garde du corps de la Sûreté, filant vers le consulat de Cuba à Montréal. Le consulat cubain n’était pas un consulat ordinaire. On le croyait être la plaque tournante de l’espionnage de l’URSS et de tous ses satellites dans cette période de Guerre froide avec l’Occident. Nous avons été reçus par un employé du consulat que je ne connaissais pas. Il m’invita à attendre dans la réception du consulat, puis il disparut à l’intérieur avec Me Mergler. Je me souviens de cette petite salle de réception aux murs gris, sans aucune photo ni cadre sur les murs. Quelques chaises droites, un comptoir avec personne à l’arrière, puis il y avait ce qui me semblait être une lentille, en haut du mur en face, qui semblait me regarder. C’était pour le moins spécial. J’ai attendu dans cette pièce une heure, peut-être plus, sans que personne ne vienne me renseigner ou se préoccuper de moi. Je pensais que la police, les ravisseurs, James Cross, étaient là qui attendaient comme moi. Enfin, la porte s’ouvrit, Me Mergler sortit seul et me dit : « J’ai obtenu le mandat d’agir pour le gouvernement cubain, je suis donc prêt à vous suivre. « Qu’est-ce qui a pris tant de temps ? » lui ai-je demandé. « Il fallait téléphoner à Cuba au ministère des Affaires étrangères. Même une fois en contact, il a été nécessaire d’attendre que l’on trouve Raoul Castro pour obtenir son accord ».
Lien présent sur Google en 2020, disparu depuis : https://sites.google.com/site/criseoctobre70/chapitre-5---la-delivrance
Ce témoignage du déroulement des négociations est corroboré par Mergler lui-même qui publie son récit des événements dans le quotidien de langue anglaise, The Montreal Star, quatre jours après la libération de Cross, soit le lundi 7 décembre 1970. Il insistait dans son récit sur la mission humanitaire qu’il s’était donnée en acceptant de négocier la libération de Cross en échange de leur sauf-conduit pour Cuba tout en soulignant qu'il s'opposait à leur action criminelle. On lira ci-dessous un extrait de l’article signé par Mergler ainsi que l'image du texte intégral de son récit, tel que publié le lundi 7 décembre 1970, dans The Montreal Star.
On peut ainsi présumer que les membres de la cellule Libération du FLQ connaissait la réputation d’avocat progressiste de Mergler lorsqu’ils avaient demandé qu’il les représente dans leurs négociations avec les autorités.
L'extrait du récit de sa participation :
«I most certainly wish to bring this matter to an end without death or injury to anyone, écrira-t-il. But I must say that I am keenly aware that it can be considered an offence to act on behalf of persons who may be in the act of committing a crime. (…)
I want it understood that I am doing this at your specific request. I want it understood that I shall intervene to assist the Cuban diplomatic mission whom I have had the occasion to represent in the past. I shall want a writing to the effect that I am doing this for humanitarian reasons».
Pour en savoir plus, on consultera :
Mon compte rendu de Simon-Pierre Lacasse. Les Juifs de la Révolution tranquille, paru dans Études d'histoire religieuse, publication de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique
Le fonds d'archives de Bernard Mergler
De même que le témoignage de sa fille Donna Mergler dans l'ouvrage Les Juifs progressistes au Québec, de Allan Gottheil, éditions Par ailleurs, 1988.
***
Lire aussi :
Les Juifs et les élites québécoises : des susceptibilités à ménager
Les Juifs du Québec : In Canada We Trust. Réflexion sur l'identité québécoise
Sur la Crise d'Octobre :
https://www.tolerance.ca/Rubrique.aspx?ID=184&L=fr
[1] Victor Teboul, « Déserter, lâcheté ou héroîsme ? », Perspectives-Dimanche, no 42 (vol.1), 19 octobre 1969, p. 2,3,4, 6.
[2] Émile Boudreau et Léo Roback (1988). L'histoire de la FTQ, des tout débuts jusqu'en 1965, Montréal, FTQ. Centrale des syndicats du Québec, 2002.
--------------------------
Vous avez aimé cet article ? Contrairement aux médias traditionnels et numériques, Tolerance.ca ne reçoit pas de financement de Google ou de Facebook. Il ne reçoit aucune subvention gouvernementale ou de financement provenant d’entreprises privées ou d’organismes communautaires. Vous pouvez soutenir l’indépendance de Tolerance.ca et son esprit critique en vous y abonnant. Pour plus d’informations, cliquez ici.
10 novembre 2020
Mise à jour 3 octobre 2025